Ce mois-ci, Potzina a proposé un thème bien étrange pour la saison pour son ciné-club: les films de Noël. c'est l'occasion pour moi de vous parler de mon film de Noël préféré, mon film de Noël plaid et orangettes, celui que je regarde toujours à cette période de l'année et même en dehors, et qui a ma préférence sur même La vie est belle de Capra (ouais, carrément).
Pour comprendre mon choix, on va faire un petit retour en arrière sur mon histoire de Noël favorite, depuis bien longtemps. Mais regardez qui voilà! Une « étrange silhouette, celle d’un enfant ; et néanmoins, pas aussi semblable à un enfant qu’à un vieillard vu au travers de quelque milieu surnaturel, qui lui donnait l’air de s’être éloigné à distance et d’avoir diminué jusqu’aux proportions d’un enfant ». Le fantôme des Noëls passés! Suivons le!
Années 80. Une petite fille en sous-pull qui gratte, collants qui grattent et robe-salopette en velours est assise par terre, un livre d'images devant elle. C'est la période de Noël et elle vient d'avoir son nouveau "Raconte-moi des histoires" (ancêtre de l'audio-book) spécial Noël. Dans le radio-cassette, une voix lui narre une histoire fantastique. Une histoire qui fait encore plus aimer Noel. Parce qu'elle rit des péripéties d'un vieil avare, parce qu'elle pleure devant la tragédie du petit Tim, parce qu'elle frissonne de peur devant un devant un fantôme de mauvais augure. Tous les éléments de ce qu'elle va aimer plus tard au cinéma sont là, sur le papier et sur la bande de la cassette. Elle en oublie le sous-pull et les collants qui grattent et se met à rêver. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de découvrir son premier grand auteur, son premier grand classique: Un chant de Noël, de Charles Dickens.
Vous l'aurez donc compris, le film que j'ai choisi a donc un rapport avec le plus beau conte de Noël jamais écrit, une histoire de rédemption magnifique, avec le vieux grincheux le plus adorable du monde. Mais il a un truc en plus, un truc qui hurle "magie de Noël" à tue-tête, un truc adoré des petits et des grands: un truc vert avec une voix nasillarde, un truc rose avec une chevelure blonde, un truc bleu avec un nez qui pendouille. Oui, oui? Comment rendre Dickens encore plus magique? Il suffit d'y ajouter... DES MUPPETS!!!!!
Mon film de Noël préféré est donc Noël chez les Muppets, chef d'oeuvre (non, je n'ai pas peur des mots) de Brian Henson, fils de Jim du même nom, le marionnettiste le plus fabuleux que la terre ait porté.
Mais attention, la cloche sonne et voici venir un jovial géant aux joues bien rouges: c'est le fantôme du Noël présent.
Une jeune femme d'une beauté irréelle (ben quoi, c'est Noël, on offre un peu de rêve, que diable) est assise en pyjama sur son canapé. Devant elle, un chai au chocolat, des chocolats, des cadeaux de Noël à finir de coudre à la main, et un écran diffusant Noël chez les Muppets. Elle voit ce film pour la 30ème fois, mais elle se sent toujours comme une enfant en sous-pull et collants qui grattent. Elle rit aux facéties de Gonzo qui dit être Charles Dickens, elle s'amuse des apparitions fantomatiques des 2 vieux du balcon, elle s'émeut des malheurs de la famille de Kermit et Miss Piggy. Elle chante les chansons qu'elle connait maintenant par coeur, qui sont drôles et adorables. Et elle surkiffe Sir Michael Caine dans ce qui pour elle est son meilleur rôle à ce jour: celui d'Ebenezer Scrooge, vieux grigou avare et méchant, qui va redécouvrir la bonté et la joie de Noël grâce à trois fantômes fabuleux. Elle trouve que les relations entre l'acteur et les marionnettes fonctionnent à merveille, et qu'on oublie très vite que l'un est fait de chair et de sang, et les autres de fils, de tissu et de mécanismes. Elle est tellement bien avec ce film qu'elle en oublie l'aiguille qui pique et se met à rêver.
Voilà, moi je vais rester un peu là, à attendre le dernier son de cloche et le fantôme des Noëls à venir. Et j'espère qu'il me montrera une vieille dame, entourée d'enfants, chantant à tue-tête "Thankful heart"
Merry Christmas to us all!











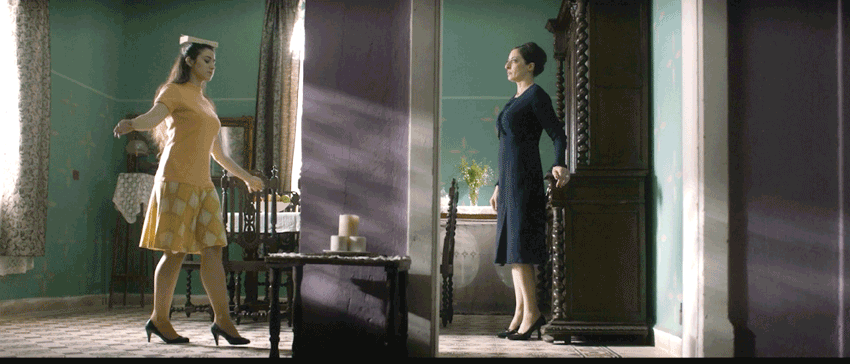







.jpg)































